Luc nous rapporte que les gens qui s’étaient déplacés au bord du Jourdain demandaient à Jean Baptiste « Que devons-nous faire? » C’est une question que nous connaissons bien. Il y a tellement de choses que nous devons faire, au point que parfois, on ne sait même pas par où commencer. Je ne sais pas pour vous, mais à certaines heures, ou même souvent, ce que nous devons faire nous empêche de faire ce que nous aimerions faire. Vous devinez que ce n’est pas leur emploi du temps qui préoccupait les auditeurs de Jean Baptiste quand ils demandaient : Que devons-nous faire?.
Mais qu’est-ce qui fait qu’ils posaient la question? C’est qu’ils avaient été touchés. Le sombre message de Jean les avait ébranlés. Il parlait en effet d’« échapper à la colère qui vient. La hache est prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. »
C’est normal que devant un événement menaçant, notre réflexe soit : « Que pouvons-nous, que devons-nous faire? » En m’inspirant du contenu d’une petite brochure distribuée par la Croix Rouge, je dirais que si nous étions confrontés à un tremblement de terre, une inondation, un incendie domestique ou un feu de forêt, une tornade, une tempête de verglas, etc., nous nous demanderions : Que devons-nous faire?
Oui, encore aujourd’hui, ce que nous avons fait peut avoir des conséquences dramatiques, mais aussi ce que nous n’avons pas fait alors que nous aurions dû faire. La crise climatique en est une parfaite illustration. Pour nommer ce type de conséquences, on aurait dit en ce temps-là, comme Jean-Baptiste, « un terrible jugement ».
« Que devons-nous faire »? Observons que dans sa réponse, Jean-Baptiste ne dit pas qu’il faut prier, aller au temple, lire la Bible. n’énumère pas une liste de comportements précis. S’inspirant plutôt des prophètes qui l’ont précédé, il répond par cette formule générale : « Produisez des fruits qui témoignent de votre conversion », c’est-à-dire d’un changement de vos priorités.
Mais comment traduire en acte cette conversion? Qu’est-ce que « produire des fruits? ». Que nous faut-il donc faire concrètement? La réponse de Jean suggère un agir individuel qui laisse entrevoir un projet de société qui nous sortirait du « cul-de-sac des intérêts particuliers »1, qui s’articulerait autour non du chacun pour soi, mais du partage. Vous avez deux tuniques? Vous ne manquez pas de nourriture? Allez! Élaguez vos garde-robes, faites le tour de votre garde-manger, remplissez les friperies et inondez Moisson Québec ou la Bouchée généreuse.
Il n’y a pas une manière unique et universelle de « produire des fruits qui témoignent de notre conversion ». C’est à chacune, à chacun, selon sa situation de vie, de donner un visage concret à ce que nous proclamons ensemble dans notre confession de foi où nous affirmons que « nous sommes appelés à constituer l’Église pour rechercher la justice et résister au mal ». Déjà, Jean le Baptiste avait ce sens du caractère personnel de la conversion et de ses effets. Vous êtes fonctionnaire? N’exigez rien de plus que ce qui a été fixé, c’est-à-dire ne soyez pas tatillons, ne faites pas d’excès de zèle. Vous êtes policier, gardien de sécurité ou militaire? N’abusez pas de votre pouvoir, gardez-vous des pots de vin.
En donc, ce qui nous concerne, les « fruits de la conversion » seront différents. Plusieurs d’entre nous sommes des retraités. Comment notre foi inspire-t-elle notre emploi du temps ou le partage de nos économies? Et puisque durant cet Avent nous nous arrêtons aux défis de la vie familiale, quels sont les fruits de la conversion que doivent produire les parents de jeunes enfants? À la question « Que devons-nous faire? », chacune et chacun trouve sa réponse selon sa culture et selon la personnalité de chacun de ses enfants. Mais on devine que Jean pourrait avoir suggéré aux parents quelque chose de plus général comme : apprenez à vos enfants à « faire » ce qu’ils doivent à la maison, à se comporter avec respect envers vous et envers leurs frères et sœurs; mais, surtout, peut-être, laissez vos enfants être des enfants, donnez-leur la chance de vivre à plein cet âge de l’insouciance, de l’improvisation, de la curiosité et de la découverte; respectez-les dans leur corps et leur esprit, encouragez-les, félicitez-les, apprenez-leur le sens de l’autre et le sens de la beauté du monde.
Ce matin du 15 décembre, à dix jours de Noël, à l’étape où nous en sommes dans notre vie, nous rappelant la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’intéresse passionnément à nous et à l’humanité, Seigneur, que devons-nous faire? Que dois-je faire?
*
Il y a la question de ce que nous devons faire, mais il y a aussi la question de l’esprit dans lequel nous le faisons. On trouve, en effet, dans l’évangile de Luc, deux autres personnages qui questionnent Jésus, et exactement dans les mêmes termes : « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? » Le premier est un légiste (Lc 10,25) et le second un notable (Lc 18,18). Et Jésus ne dit à aucun des deux ce qu’il doit faire. Comme Jean, il les renvoie à la source première de nos motivations et, pour cela, il renvoie à ce qu’on trouve au cœur de la foi juive. Le légiste proclame « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Et Jésus lui répond : « Fais cela, AIME, et tu auras la vie » (10,28).
La situation est un peu plus complexe dans le cas du notable. Jésus commence par lui rappeler les principaux commandements, qui interdisent l’adultère, le vol, le faux témoignage, le manque de respect envers le père et la mère », et en l’entendant répondre fièrement : « Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse » (18,20-21), Jésus dit à cet homme qui a su « faire » tout ce qu’il fallait faire : « Une seule chose te manque ». En l’invitant à se départir de ses biens en faveur des pauvres et à le suivre (18,22-23), il lui révèle que riche de sa performance et de son idéal d’obéissance parfaite, il lui manque l’essentiel : sortir de soi pour aller vers l’autre et découvrir la gratuité de la vie éternelle.
On pourrait dire qu’aux deux il manquait le sens de la grâce.
Ne sentez-vous pas comment, s’il réaffirme, comme Jean-Baptiste, l’importance du « faire », Jésus déplace la question? Ne cherche-t-il pas à ouvrir les yeux de ceux et celles qui « font » ce qu’il faut faire dans le but d’obtenir quelque chose en retour, ici la vie éternelle? Il arrive, par exemple, qu’on fasse ce qu’on doit faire pour se faire valoir. Il arrive aussi qu’on pense qu’en faisant ce qu’on doit faire, on peut « mériter » la faveur de Dieu ou la vie éternelle. Jésus dénonce ce piège. Il invite à sortir d’une mentalité mercantile de « donnant-donnant », Jésus invite le légiste à cultiver une attitude fondamentale, l’amour du prochain, le service de l’autre, sans rien attendre en retour, comme le Samaritain dont la parabole suit immédiatement. Et Jésus invite le notable à devenir non plus celui qui donne, mais celui qui reçoit.
Au fond, il me semble que Jésus invite à accéder, par le chemin du faire, au domaine de l’être. Cet évangile de la grâce nous invite à reformuler la question : non plus « Que devons-nous faire? », mais « Que devons-nous être? » Peut-être même « Qui devons-nous être? »
Voilà, me semble-t-il, ce que les premiers chrétiens, et Paul le premier, le champion du faire par l’obéissance scrupuleuse à la Loi, voilà ce que les premiers chrétiens avaient compris et cherché à vivre. Non plus dans la performance, fût-elle animée par les motivations spirituelles les plus élevées, mais dans la docilité à l’Esprit qui intériorise la loi en convertissant la préoccupation des comportements en culture des attitudes.
N’est-ce pas ce que nous avons entendu dans l’extrait de la lettre aux chrétiens de la ville de Philippes? Paul ne recommande à la communauté aucun comportement, ne fixe aucune obligation d’agir. Il invite plutôt, et avec insistance, à cultiver des attitudes : la joie, la bonté, la confiance sereine, l’action de grâce et la paix. Les théologiens du Moyen-Âge, suivant la pensée d’Aristote, avaient cet adage : l’agir suit l’être.
Alors, dans le moment de recueillement qui vient, laissons-nous porter par la question : Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je sois?
LECTURES BIBLIQUES
1Heureuse expression empruntée à Yves Carrier, du CAPMO.
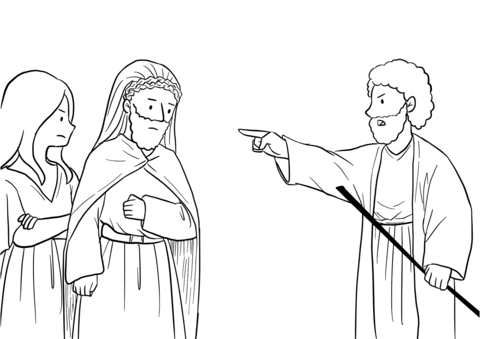
Un commentaire
Un dicton dit Bien faire et laisser braire